Tout a commencé quand j’ai reçu ce message d’Arthur Establie, un des talentueux acteurs de la dernière génération de spéléonautes :
 – Bonjour Francis, j’espère que tu vas bien. Un ami vient de retrouver ce dévidoir à Saint Sauveur et il voulait savoir si c’était le tien ? Il a été repêché à -77m, entre le puits Le Guen et la trémie…
– Bonjour Francis, j’espère que tu vas bien. Un ami vient de retrouver ce dévidoir à Saint Sauveur et il voulait savoir si c’était le tien ? Il a été repêché à -77m, entre le puits Le Guen et la trémie…
– Wahou ! Oui c’est le mien. Je l’avais abandonné lors de mon « pépin » le jour de la pointe.
– Waouw, exceptionnel ! Je transmets l’info.
Alors j’ai voulu partager avec vous ce « Waouw » qui résonnait aussi dans ma mémoire. Je n’aime pas trop évoquer le passé mais il faut bien reconnaître que j’étais touché par cette découverte qui confirmait que cette incursion dans l’au delà n’était pas le fruit de mon imagination : je l’avais bien vécue. Et le fil de l’aventure avait subsisté, reliant plusieurs générations…
Les scaphandriers du désert
 J’avais témoigné de ce qui m’était arrivé dans un de mes premiers livres, dont voici un extrait…
J’avais témoigné de ce qui m’était arrivé dans un de mes premiers livres, dont voici un extrait…
Nous avions déjà à notre actif la plus longue plongée souterraine, c’est pourquoi, tout naturellement, je m’intéressai aux plongées profondes. Notre technique et nos équipements se perfectionnant sans arrêt, nous pouvions envisager l’exploration des galeries qui restaient jusque-là un obstacle. Nous pouvions nous attaquer à ces réseaux géants qui, sans tenir compte des limites humaines, s’enfoncent dans le calcaire. C’est dans l’une de ces sources lotoises, au nom trompeur de Saint-Sauveur, que je faillis perdre la vie en 1981.
Isolée en pleine nature, cette source majestueuse surgit soudain entre les pieds de deux massifs plantés de chênes-lièges. La vasque d’un bleu d’opale mesure bien 30 mètres de diamètre, et donne naissance à une rivière pressée, qui se jette plus loin dans l’Ouysse. Courbés sous l’acier des scaphandres, cheminant dans la menthe aquatique et les iris, nous déclenchions souvent la fuite de poules d’eau indignées. Après toute une série de plongées d’exploration menées à tour de rôle avec mon frère, c’est maintenant à mon tour de tenter une «pointe» ultime.
 En quelques coups de palmes, je suis au centre du lac et, purgeant l’air contenu dans mon vêtement, je coule lentement. L’eau n’est pas claire à cause des algues microscopiques qui se développent au soleil. A 15 mètres sous la surface, je m’agenouille sur une dune de sable inclinée. Je règle la couronne crantée de la montre sur le zéro et pour suis la descente. La musique que font les bulles d’air en s’envolant a changé : je sais que l’arche de la caverne s’est refermée au-dessus de ma tête. L’eau s’est considérablement éclaircie. Je me retourne et le vaste porche apparaît à contre jour, dans une lumière irréelle. Une grappe de bouteilles pendues au bout d’une corde se détache en filigrane : les réserves prévues pour le palier de décompression, dont l’embout qui amène l’oxygène pur depuis la surface.
En quelques coups de palmes, je suis au centre du lac et, purgeant l’air contenu dans mon vêtement, je coule lentement. L’eau n’est pas claire à cause des algues microscopiques qui se développent au soleil. A 15 mètres sous la surface, je m’agenouille sur une dune de sable inclinée. Je règle la couronne crantée de la montre sur le zéro et pour suis la descente. La musique que font les bulles d’air en s’envolant a changé : je sais que l’arche de la caverne s’est refermée au-dessus de ma tête. L’eau s’est considérablement éclaircie. Je me retourne et le vaste porche apparaît à contre jour, dans une lumière irréelle. Une grappe de bouteilles pendues au bout d’une corde se détache en filigrane : les réserves prévues pour le palier de décompression, dont l’embout qui amène l’oxygène pur depuis la surface.
La galerie descendante, jonchée de blocs de calcaire sculptés est longue de 200 mètres. La pression m’écrase et je dois gonfler à chaque fois le vêtement pour la compenser. Je suis depuis longtemps sous l’emprise de la narcose : ma vision s’est rétrécie, tous les sons prennent une acuité extraordinaire : respiration, chocs des bouteilles sur la roche, battements de cœur, éclatement des bulles d’air sous les sur plombs. La première sensation est désagréable, puis elle se transforme en euphorie, en optimisme, en bien-être exagéré : l’azote, devenu poison à cette pression, a commencé à faire son effet. Je regarde l’aiguille rouge du profondimètre : elle est calée sur – 68 m.
Voici la bouche de la galerie horizontale : l’eau est transparente et mes lampes y révèlent des profondeurs indigo. La roche est pure, sans dépôt, couleur d’ocre rouge. Je laisse un de mes relais ici même, accroché sur le fil d’Ariane, et pénètre dans la nouvelle galerie. Je regarde fréquemment la montre car il s’agit d’aller vite : nos incursions en profondeur sont limitées à cause des durées de décompression. Vite mais pas trop vite ! Dans ce monde minéral, sans repères, inhumain, où la pression terrible détériore le raisonnement et estompe les avertissements du corps, je ne me rends pas compte que je nage beaucoup trop vite. La taille de la galerie – près de cinq mètres de diamètre – me trompe : pour régler ma vitesse, j’ai l’habitude de me fier au défilement des parois dans le faisceau des lampes, mais la plupart des conduits que j’ai explorés jusqu’alors ne mesuraient que deux ou trois mètres de large. Aussi, pour retrouver cette sensation de vitesse, j’ai tendance à accélérer sans arrêt. Le nouveau phare de cinquante watts y est aussi pour quelque chose : je vois très loin devant moi. Sans que j’en prenne conscience, mon organisme accumule du gaz carbonique résiduel. A ces profondeurs, l’air devient pâteux, difficile à ventiler. Je viens de parcourir 200 mètres supplémentaires entre – 68 et – 72 mètres de profondeur, et dépose le deuxième relais. L’extrémité du fil d’Ariane est attachée sur une roche en saillie : c’est le point extrême atteint par Eric. Au-devant : l’inconnu. Je devine un énorme gouffre noir, qui trépane le sol. La suite semble encore plus profonde : il est encore temps de reculer, mais je me sens très bien. Mon cœur bat un peu vite et j’ai chaud aux tempes, mais je mets ça sur le compte de l’émotion : ce que je suis en train de réussir là, personne ne l’a tenté avant moi.
Calmement, je vide l’eau qui envahit mon masque, change d’embout, raccorde mon propre dévidoir de fil au terminus d’Eric. Enfin, avec difficulté, je déchiffre les indications de mes instruments : ça va, il me reste assez d’autonomie. Alors sans hésitation, je survole la lèvre du puits et me jette dans le trou noir. Obscurité. Pas de fond en vue. Les quatre membres écartés, à la manière des parachutistes, je coule. Peu à peu, le fond apparaît lentement, comme une épreuve dans le bain du photographe. Est-ce que ce sont des graviers ou des rochers vus de très haut ? J’atterris sur des graviers. Au-delà, Saint-Sauveur m’ouvre à nouveau une vaste avenue qui mène au paradis : quatre mètres de haut, sept à huit mètres de large. La roche est criblée de cratères lunaires dont la couleur de rouille se marie bien avec le bleu de l’eau carbonatée. Mon excitation est à son comble ; je me sens en pleine possession de mes moyens, conscient de réussir l’impossible… J’ai déjà déroulé cent mètres de fil, subjugué par le spectacle. Jusqu’où ce siphon géant va-t-il nous entraîner ? J’évolue à – 78 m !
Et soudain, c’est le drame, comme une vague chaude qui me submerge : la goulée d’air que je viens d’avaler ne me suffit pas. La seconde encore moins. On m’écrase les poumons. Une terrible envie de pleurer me sert la gorge. J’ai compris : c’est l’hypercapnie, l’intoxication au gaz carbonique. La seule de ma courte carrière, et la dernière car je ne m’en sortirai pas. Trop loin, trop profond… Le corps, lui, a réagi : dévidoir lâché, volte-face, les deux mains cramponnées sur l’embout buccal, j’expire comme un forcené. «Souffle, souffle… il faut souffler !» me dit une voix, et je souffle, tremblant de peur à chaque inspiration, peut-être la dernière. Je suis aveugle : un voile noir est descendu sur mes yeux. Mon corps entier est pris de picotements. Je vomis et l’air, pourtant précieux, n’arrive plus à franchir ma gorge secouée de contractions. L’air siffle dans mes oreilles bourdonnantes. Je me rappelle maintenant la musique du diable : un oratorio d’organiste dément. Expirer à fond, c’est la seule chose qui peut me sauver, mais je sens que j’abandonne. Trop dur. Ne plus souffrir. Je vais lâcher mon détendeur et avaler une pleine goulée d’eau. En finir !
Quelque chose se passe alors, quelque chose de profondément troublant, qui va me laisser des marques pour le restant de mes jours : comme si je me détachais de mon corps, j’assiste à la mort d’un autre moi-même. Je me vois, tendu en arc, entre deux eaux, secoué de frissons et laissant échapper les dernières bulles vitales. Chaque seconde dure une éternité. Une lumière blanche, aveuglante, venue de la gauche, envahit tout mon champ de vision. Il fait chaud. Terriblement proches, des voix retentissent, certaines accélérées comme provenant d’un magnétophone qu’on rembobine : «Francis s’est noyé… il s’est tué en siphon… Francis Le Guen était l’un des meilleurs… il a voulu aller trop loin… C’était sa dernière plongée…» Puis je vois mes parents, ma femme restée dehors, mon frère Eric qui plongera tout à l’heure à la recherche de mon cadavre et sera chargé d’annoncer la nouvelle. Si je pouvais admettre l’idée de la mort, je ne peux supporter ça ! C’est de nouveau l’obscurité, mon sang bouillonne et ma poitrine est toujours secouée de hoquets mais je respire ! Un coin du voile se lève et avec surprise j’aperçois entre mes cuisses le fil d’Ariane qui défile doucement. Inconsciemment, j’ai continué à palmer vers la sortie. Soudain, aussi brusquement qu’ils sont venus, les symptômes disparaissent ! L’air arrive bien, je vois clair, je suis vivant !
Le puits… Je monte tout doucement, en me tractant avec les mains, terriblement choqué. Chien battu, sentiments et émotions rentrés. Je suis seul et petit. Je récupère le deuxième relais. Il me reste 400 mètres avant de sortir, mais le niveau de gaz carbonique dans mon sang est encore dangereusement élevé. J’ai l’impression d’avoir, au cours de l’accident, complètement vidé ma réserve dorsale, et une sourde angoisse me ronge : celle de manquer d’air pour atteindre mon premier relais. Cinquante mètres plus loin, un deuxième essoufflement me terrasse à – 72 m. Je refoule mes sanglots. C’est trop bête. Je m’arrête totalement, bien décidé à le dompter : refuser la détresse, expirer tant et plus, garder le détendeur en bouche. La main de fer qui m’étouffe se desserre beaucoup plus vite que tout à l’heure : elle cède.
Un petit triangle bleu : le jour. Je m’installe à – 24 mètres pour un premier palier, et mes nerfs lâchent : je suis secoué de tremblements, mon cœur cogne, j’ai très froid et j’urine dans ma combinaison. Devant mes yeux, au ras du sable, tout un ballet de petits poissons noirs, vivants. Je remonte progressivement, dans un décor somptueux. Près de deux heures et demie me séparent encore de l’air de tous les jours et de la voix des vivants. J’ai le temps de me calmer, de ressasser les détails de l’aventure, tout en renonçant – pour quelques heures seulement – aux plongées profondes…
Ces instants tragiques restent profondément imprimés en moi, et il ne se passe pas une plongée sans que j’y pense. J’en ai parlé a l’un de mes amis qui est médecin sur une barge pétrolière employant des plongeurs professionnels, en mer du Nord.
«  Le voile noir ! My God ! quand nos gars en sont là, ils sont considérés comme morts ! »
Le voile noir ! My God ! quand nos gars en sont là, ils sont considérés comme morts ! »
Quelle sorte d’expérience avais-je donc vécue dans les profondeurs de Saint-Sauveur ? Avais-je donc fait quelques pas dans l’au-delà, avant d’en revenir ? A ce jour, personne ne s’est risqué à replonger là. Mais je sais que moi, j’y retournerai. J’ai laissé une partie de moi-même là-bas… j’y ai rendez-vous avec mon cadavre.

Une partie du matériel utilisé à l’époque : tri 15 litres plus bouteilles relais, premiers vêtements étanches, casques et… 4 lampes de poche !
42 ans plus tard…
Mais les jours, les mois, les années ont passées et, happé par d’autres activités, je n’y suis jamais retourné. Et beaucoup d’explorateurs et parmi les meilleurs sont venus à Saint Sauveur et ont considérablement prolongé le dévellopement de cette source, baptisant au passage de mon nom le puits profond que j’avais découvert.
J’étais convaincu que les « terminus » étaient faits pour être dépassés et ne fut donc pas surpris par les performances nouvelles dont la source de Saint Sauveur fut le théâtre. Citons les plongées du polonais-marseillais Frédéric Swierczynski, de l’anglais Rick Stanton, du polonais Krysztof Starnawski qui à ce jour a atteint le point le plus extrême après un incroyable passage profond.
Dans le même temps la pratique de la plongée souterraine s’était considérablement démocratisée et le nombre des pratiquants à la recherche de sources à visiter, en augmentation constante. D’un côté les explorateurs (toujours une poignée), et de l’autre une armée de plongeurs spéléos suréquipés de diplômes et de matériel, venus de toute l’Europe et même de plus loin à la recherche de sensations dans les grandes « classiques » du Lot ou de l’Ardèche. Signe des temps, à l’image de la plongée en mer. Avec parfois des conflits de techniques notamment dans la façon d’équiper les galeries en fil : Tous les embranchement reliés mais avec des flèches indiquant le sens de la sortie, à « la française » ou seulement les grands axes, à charge aux plongeurs de les relier temporairement en déroulant leur « jump line », à l’anglo saxonne.
 Confusions de méthodes et erreurs sur les différentes topographies qui circulaient et qui, vu la fréquentation, mena même des plongeurs à s’égarer. Décision fût donc prise de nettoyer tous les fils existants, de re-équiper et de re-topographier proprement « à la française » les galeries du siphon géant pour éviter de futurs accidents.
Confusions de méthodes et erreurs sur les différentes topographies qui circulaient et qui, vu la fréquentation, mena même des plongeurs à s’égarer. Décision fût donc prise de nettoyer tous les fils existants, de re-équiper et de re-topographier proprement « à la française » les galeries du siphon géant pour éviter de futurs accidents.
C’est Thomas Delpech, 40 ans, du groupe « Ratepenade du Lot » (qui signifie chauve souris en occitan) qui s’attela au re-équipement de la zone litigieuse. Et c’est au bas du puits, à demi enfoui dans les graviers, qu’il retrouva mon dévidoir dans un écheveau de fil : les crues violentes lui avait fait rebrousser chemin !
Topographie en plan de la zone du « shunt ». © Thomas Delpech
Une longue histoire…
Voici un aperçu des différentes explorations de la source. Hélas fragmentaire : il en manque beaucoup…
 En 1954, Y. Dufour et Guy de Lavaur plongent la cavité.
En 1954, Y. Dufour et Guy de Lavaur plongent la cavité.- Le 29/07/1980, Eric et Francis Le Guen s’arrêtent à –78 à 350m de l’entrée dans une vaste galerie horizontale.
- En 1986, Xavier Goyet décède de retour d’une plongée d’exploration en profonde.
- Durant les années 90, l’équipe de Patrick Jolivet et celle d’Hubert Foucart (FFESSM/LRMP) progressent jusqu’à 580m de l’entrée, à –92.
- En 2001, Rick Stanton (UK) trouve une passage en lucarne dans le cul-de-sac jusqu’alors terminal et descend une galerie jusqu’à –103 (610m).
- Au mois de mars 2004, Jacques Berou, assisté de Jean Gado et Fabrice Deruty descend à –110 (620m).
- En avril 2004, Rick Stanton progresse d’une quarantaine de mètres depuis –103 jusqu’à –120m (650m) malgré une visibilité réduite (<5m).
- En août 2004, le même Stanton ajoute 70 mètres (720m), dans une galerie à -120m qui remonte à -110m avant de plonger à nouveau. Arrêt sur rien à –133.
- En août 2018, Starnawski avance jusqu’à plus de 1300m de l’entrée, à très grande profondeur.
Ne doutons pas que ce terminus sera de nouveau dépassé, malgré les obstacles qui paraissent monstrueux. La technique évolue sans cesse, les barrières psychologiques s’effondrent : nous aurons bientôt des nouvelles de « l’au delà »…






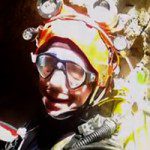


0 commentaires